Dans notre premier article, nous avons vu que la douleur chronique n’est pas seulement un symptôme physique, mais une expérience physiologique complexe influencée par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Dans le deuxième, nous avons exploré les options de traitement, allant des approches pharmacologiques aux interventions multidisciplinaires. Si la lecture de ces articles se fait loin, ou si vous n’avez pas eu la chance de les lire, nous vous invitons à la faire.
Comprendre sa condition de santé est essentielle pour progresser vers un rétablissement, mais souvent l’information théorique ne suffit pas pour se mettre en action. Le véritable défi, pour beaucoup de personnes vivant avec une douleur chronique, est de réussir à maintenir des habitudes de vie saines malgré la douleur. Si tel est votre cas, ne vous flagellez-pas, il s’agit d’un défi considérable qu’il faut relever une étape à la fois. Dans ce dernier article de cette trilogie, nous allons donc nous pencher sur des facteurs qui peuvent favoriser des changements positifs.
Savoir pourquoi c’est important
Les habitudes de vie – activité physique, sommeil de qualité, alimentation équilibrée et gestion du stress – ne guérissent pas la douleur chronique. Cependant, elles jouent un rôle crucial pour améliorer la qualité de vie, réduire l’impact de la douleur et préserver l’autonomie, malgré la présence de la douleur.
Les recherches démontrent que l’exercice physique, par exemple, contribue à diminuer la douleur, améliorer la mobilité et renforcer la confiance en ses capacités fonctionnelles. Certaines approches spécifiques (comme le Pilates, la thérapie McKenzie ou les exercices de flexibilité) montrent des résultats particulièrement intéressants. Mais au-delà du type exact d’activité, c’est la régularité qui compte le plus. Nous y reviendrons plus bas dans le texte.
Se questionner sur sa motivation
Pourquoi bouger? Pourquoi continuer malgré les obstacles, aussi nombreux soient-ils? La motivation est un facteur déterminant dans l’adhésion aux saines habitudes de vie. Les études révèlent que les personnes qui trouvent du sens dans leurs activités (plaisir, autonomie, cohérence avec leurs valeurs ou objectifs de vie) sont plus susceptibles de maintenir leurs efforts à long terme.
À l’inverse, lorsque la motivation repose uniquement sur des pressions externes (faire plaisir au médecin, « devoir » s’entraîner), l’adhésion est plus fragile. Se questionner sur ce qui nous motive réellement est donc une étape clé pour persévérer.
Exemples de questions qui peuvent vous aider :
→ Quelle est la première activité que je ferais si je n’avais plus mal?
→ Sans douleur, laquelle de mes qualités personnelles pourrait refaire surface?
→ Avec qui la douleur m’empêche de passer plus de temps de qualité?
→ Quelles sont les activités qui me font du bien ou qui me procurent du plaisir?
La motivation n’est pas une inspiration divine, c’est plutôt un engagement qui s’exprime par des actions concrètes vers l’atteinte d’un résultat identifiable.
Surmonter les peurs et croyances limitantes
Vivre avec de la douleur chronique s’accompagne souvent de kinésiophobie, soit la peur de bouger par crainte d’aggraver la douleur ou de causer des dommages. Il s’agit d’un cercle vicieux commun et tout-à-fait compréhensible. Cependant, éviter de bouger entraîne un déconditionnement du système nerveux et une perte de capacités musculaires. Ce déconditionnement généralisé devient donc central à la perpétuité de la douleur chronique, en plus de nous mettre plus à risque de blessure. Le cercle vicieux de la kinésiophobie est donc lancé.
Bonne nouvelle, ce cercle vicieux peut être interrompu et même renversé pour devenir un cercle vertueux! Tout d’abord, comprendre que la douleur n’est pas toujours signe de dommage physique est essentiel. (À ce sujet, retournez lire notre premier article.) Ensuite, il faut choisir des mouvements et des exercices progressifs adaptés à votre condition, vos besoins et vos capacités. Il a été démontré que l’accompagnement par des professionnels de la santé diminue les craintes et améliore la continuité de la pratique. Cela permet d’entrer dans le cercle vertueux: la pratique de l’activité physique engendre une meilleure condition physique qui à son tour favorise la réduction de la douleur.
Adapter les stratégies aux fluctuations de la douleur et au contexte personnel
Si vous vivez aux premières loges de la douleur chronique, vous savez très bien que la douleur n’est pas stable : il y a de bonnes et de moins bonnes journées. Comment gérer au quotidien ces variations et comment ne pas se décourager quand on ne peut pas faire aujourd’hui ce qu’on a fait hier?
Plutôt que d’abandonner, il est plus efficace d’adapter ses stratégies :
→ Réduire la durée ou l’intensité d’une activité au lieu de l’arrêter complètement. Ex. : Si hier vous êtes allés marcher 5km sur un terrain légèrement escarpé, aujourd’hui marchez 1 ou 2km sur un terrain plat.
→ Morceler votre grand objectif, en plusieurs petits objectifs réalistes. Ex. : Si vous aviez en tête de marcher 30 minutes, mais que cela s’avère trop difficile aujourd’hui, vous pouvez aller marcher trois fois 10 minutes.
→ Opter pour plusieurs types d’activités physiques qui conviendront selon les fluctuations de la douleur. Ex. : Pour les journées où la douleur est particulièrement incommodante, optez pour le tai chi, le yoga sur chaise, de la marche. Lors de bonne journée choisissez une activité à intensité plus modérée : marche rapide, musculation, elliptique, etc.
→ S’appuyer sur ses proches, des groupes de soutien ou encore des professionnels permet de ne pas rester seul face aux difficultés et de normaliser votre parcours sinueux. Ex. : Contactez votre CLSC pour voir quelles ressources pourraient vous aider, recherchez une association régionale qui offre des services à votre population, ou consultez les activités du centre communautaire.
Conclusion
Maintenir des habitudes de vie malgré la douleur chronique est un parcours exigeant, mais possible. Rappelez-vous que la régularité prime sur la performance : mieux vaut faire un peu, souvent, que beaucoup, rarement. Commencez petit, ajustez vos stratégies, et n’hésitez pas à demander du soutien.
Chez NeuroMotrix, nos kinésiologues sont là pour vous accompagner dans ce processus. Ensemble, nous pouvons trouver des moyens adaptés à votre réalité pour que l’activité physique et les habitudes de vie deviennent des alliées dans la gestion de votre douleur.
Article rédigé par Mathilde Lessard
Article révisé par Martine Lauzé
Chatgpt a été utilisé lors de la préparation de cet article.
Références
- Gilanyi, Y.L., et al., Barriers and enablers to exercise adherence in people with nonspecific chronic low back pain: a systematic review of qualitative evidence. Pain, 2024. 165(10): p. 2200-2214.
- Hayden, J.A., et al., Some types of exercise are more effective than others in people with chronic low back pain: a network meta-analysis. J Physiother, 2021. 67(4): p. 252-262.
- Crombez, G., et al., Fear-avoidance model of chronic pain: the next generation. Clin J Pain, 2012. 28(6): p. 475-83.
- Letzen, J.E., et al., Exploring the potential role of mesocorticolimbic circuitry in motivation for and adherence to chronic pain self-management interventions. Neurosci Biobehav Rev, 2019. 98: p. 10-17.
- Nijs, J., et al., Integrating Motivational Interviewing in Pain Neuroscience Education for People With Chronic Pain: A Practical Guide for Clinicians. Phys Ther, 2020. 100(5): p. 846-859.
- Nevelikova, M., et al., Motivation to exercise in patients with chronic low back pain. BMC Musculoskelet Disord, 2025. 26(1): p. 226.
- Semrau, J., et al., Effects of behavioural exercise therapy on the effectiveness of multidisciplinary rehabilitation for chronic non-specific low back pain: a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet Disord, 2021. 22(1): p. 500.

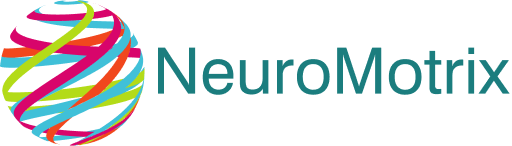





Commentaires